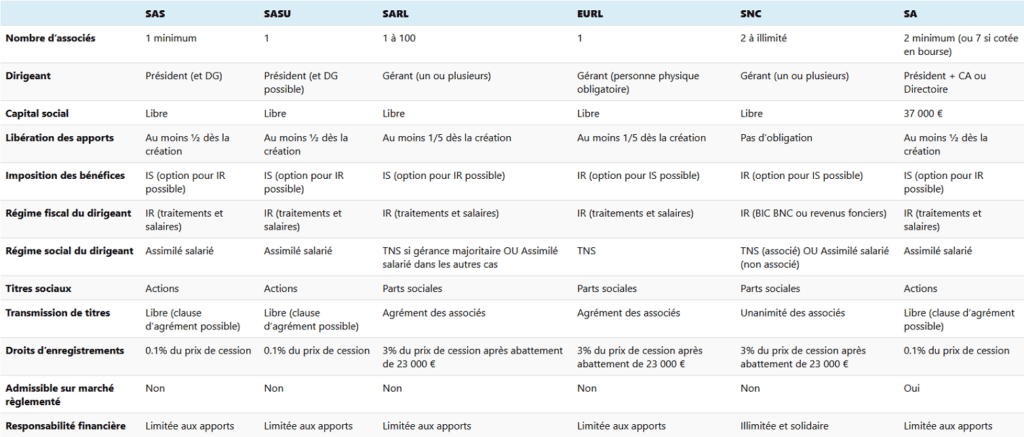Liquidation amiable : Guide procédure 2025

Mettre fin à une société est une étape importante et parfois difficile pour un dirigeant.
Lorsqu’il n’existe plus de perspectives viables ou lorsque les associés souhaitent clore l’activité en toute transparence, la liquidation amiable représente une solution à la fois rapide et maîtrisée.
À la différence d’une liquidation judiciaire, qui suppose une cessation des paiements et l’intervention du tribunal, la liquidation amiable est décidée librement par les associés, dès lors que l’entreprise est en mesure de régler l’intégralité de ses dettes.
Cet article a pour ambition de vous guider pas à pas, à travers l’ensemble des étapes de la procédure de liquidation amiable d’une société, avec un langage accessible et des repères temporels pour lever toute incertitude.
Sommaire
I – Comprendre la liquidation amiable
La liquidation amiable est une procédure qui fait suite à la dissolution anticipée de la société.
Elle est mise en place lorsque les associés décident collectivement de mettre fin à l’activité, alors même que la société reste solvable.
Autrement dit, elle peut encore honorer ses dettes au moment de la décision.
📌 À noter 📌
Cette distinction est essentielle : dès lors qu’une entreprise ne parvient plus à payer ses créanciers, elle doit obligatoirement se placer en liquidation judiciaire, sous le contrôle du tribunal.
Le but de la liquidation amiable est double :
- Réaliser l’actif : c’est-à-dire vendre les biens et récupérer les créances de la société.
- Apurer le passif : en réglant l’ensemble des dettes.
Une fois ces opérations accomplies, les associés pourront partager le solde restant, que l’on appelle le boni de liquidation, ou supporter un déficit (mali) le cas échéant.
II – Tableau récapitulatif des formalités de la liquidation amiable
Pour aider à visualiser la procédure, voici un tableau récapitulatif :
| N° Étape | Étape | Formalité | Responsable | Délai indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dissolution | Assemblée générale, Procès-verbal, Annonce légale | Associé(s) | Immédiat |
| 2 | Nomination du liquidateur | Pendant l'assemblée générale | Associé(s) | Immédiat |
| 3 | Réalisation de l’actif | Vente des biens, Recouvrement de créances | Liquidateur Amiable | 1 à 6 mois (variable) |
| 4 | Apurement du passif | Paiement des dettes | Liquidateur Amiable | 1 à 6 mois (variable) |
| 5 | Approbation des comptes | Assemblée générale finale | Associé(s) | À l’issue des opérations |
| 6 | Clôture | Publication avis clôture, Dépôt dossier complet au greffre | Liquidateur Amiable | Immédiat |
| 7 | Radiation | Radiation du RCS | Greffe du Tribunal de Commerce | Sous 1 mois après clôture |
III – Les étapes de la liquidation amiable
1 – Décision de dissolution anticipée
La première étape fondamentale d’une liquidation amiable consiste à décider la dissolution anticipée de la société.
⚠️ Important ⚠️
Il s’agit d’un choix collectif des associés, qui ne peut intervenir que si la société est encore en mesure de régler l’intégralité de ses dettes : c’est la condition même de la liquidation amiable.
Concrètement, la décision se prend lors d’une assemblée générale extraordinaire, conformément aux règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les statuts de la société.
Durant cette assemblée, les associés expriment leur volonté de mettre fin à l’activité, ce qui équivaut à anticiper l’échéance normale de la société.
Ils doivent motiver cette décision et l’inscrire dans un procès-verbal officiel, qui constituera la base juridique de toutes les formalités ultérieures.
La décision de dissolution est ensuite soumise à publicité légale : un avis doit être publié dans un journal d’annonces légales afin d’informer les tiers (fournisseurs, clients, partenaires) de la situation de la société.
Ce même procès-verbal est transmis au greffe du tribunal de commerce, qui procède à la modification de l’inscription au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).
À compter de cette date, la société change de statut : elle n’exerce plus d’activité commerciale normale, mais agit uniquement pour les besoins de sa liquidation, ce qui doit apparaître clairement sur tous ses documents officiels sous la mention « société en liquidation ».
Cette étape de dissolution est essentielle, car elle marque le passage d’une activité économique classique à la phase de liquidation proprement dite.
2 – Nomination du liquidateur amiable
En même temps que la décision de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire doit désigner le liquidateur amiable.
Ce dernier est la personne chargée de conduire toutes les opérations de liquidation au nom de la société et pour le compte des associés.
Le choix du liquidateur est libre : il peut s’agir du dirigeant en place, d’un associé, ou d’un tiers extérieur.
Rôle du liquidateur amiable
La décision doit être mûrement réfléchie, car le liquidateur aura des pouvoirs étendus :
- Il représentera la société,
- vendra ses biens,
- paiera ses dettes,
- Et procédera à la répartition éventuelle du boni de liquidation.
Les pouvoirs, la rémunération et la durée de la mission du liquidateur sont fixés lors de l’assemblée générale.
Il est important de consigner précisément ces éléments dans le procès-verbal pour éviter tout litige ultérieur.
Par ailleurs, le siège de la liquidation (qui peut être différent de l’ancien siège social) doit également être mentionné.
Le greffe du tribunal de commerce enregistre la nomination du liquidateur et la publie au registre.
Dès ce moment, le liquidateur devient l’unique représentant légal de la société, à la place du dirigeant précédent, pour toutes les démarches liées à la liquidation.
Cette passation de pouvoir est capitale pour garantir une conduite efficace et transparente de la procédure.
3 – Réalisation de l’actif
Une fois désigné, le liquidateur amiable entre dans la phase la plus concrète de sa mission : la réalisation de l’actif.
Cela consiste à vendre l’ensemble des biens appartenant à la société, qu’il s’agisse de stocks, de matériels, de véhicules, d’immeubles ou d’autres actifs inscrits au bilan.
Cette étape peut également inclure le recouvrement de créances clients encore dues à la société.
La vente des actifs doit se faire à des conditions raisonnables, dans l’intérêt des associés et des créanciers.
Le liquidateur doit agir avec prudence et loyauté, en évitant tout acte pouvant être assimilé à une vente anormale ou frauduleuse.
Par exemple, la cession d’un actif à un prix dérisoire à un proche pourrait être contestée.
Le produit des ventes constitue la trésorerie disponible pour régler le passif.
Cette étape est particulièrement délicate, car une mauvaise estimation ou une mauvaise gestion de la réalisation de l’actif peut nuire à l’apurement des dettes et retarder la clôture de la liquidation.
4 – Apurement du passif
Après avoir récupéré les fonds issus de la réalisation de l’actif, le liquidateur doit apurer le passif de la société.
Cela signifie régler la totalité des dettes et des charges en respectant la priorité de paiement des créanciers.
Le liquidateur doit dresser un état exhaustif des dettes sociales, qu’il s’agisse de dettes fiscales, sociales ou commerciales, et procéder à leur paiement dans la limite des liquidités disponibles.
En principe, la société est réputée solvable au moment de la décision de dissolution, donc ces règlements ne devraient pas poser de difficulté.
Il arrive néanmoins que des dettes apparaissent en cours de liquidation ; le liquidateur doit alors vérifier que l’actif restant est suffisant pour les honorer.
En cas d’insolvabilité
Dans le cas contraire, si l’insolvabilité est constatée après coup, la procédure de liquidation judiciaire pourra être imposée par le tribunal, ce qui constitue un risque sérieux.
La rigueur du liquidateur est donc essentielle, notamment pour établir des comptes de liquidation fiables et justifier la parfaite extinction du passif avant la clôture.
5 – Approbation des comptes définitifs
À la fin des opérations de liquidation, le liquidateur établit un compte définitif de liquidation.
Ce document retrace l’ensemble des opérations réalisées depuis la dissolution :
- Ventes des biens,
- Règlements des dettes,
- Éventuelles récupérations de créances,
- Et indique le solde final, qu’il soit positif (boni) ou négatif (mali).
Le liquidateur convoque une nouvelle assemblée générale, au cours de laquelle il présente ce compte définitif aux associés.
Ces derniers doivent approuver les comptes et donner quitus au liquidateur, c’est-à-dire reconnaître qu’il a mené sa mission conformément à leur mandat et au respect des intérêts de la société et des créanciers.
L’approbation des comptes de liquidation est un acte essentiel, car elle conditionne la clôture de la procédure.
Si le solde final fait apparaître un boni, celui-ci sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts sociales, en tenant compte des règles fiscales applicables.
6 – Clôture de la liquidation
Une fois les comptes définitifs approuvés, l’assemblée générale peut prononcer la clôture de la liquidation.
Cela marque juridiquement la fin de l’existence de la société en liquidation.
À ce stade, le liquidateur doit :
- Publier un avis de clôture de liquidation dans un journal d’annonces légales
- Et déposer au greffe le procès-verbal de l’assemblée, accompagné des comptes définitifs.
Cette formalité est indispensable : sans elle, la société resterait en « situation de liquidation » et continuerait d’être soumise à certaines obligations comptables et fiscales.
La publication de l’avis de clôture permet d’informer l’ensemble des tiers que la société a terminé ses opérations et qu’il n’existe plus de créances ni d’obligations en cours.
En pratique, la clôture est souvent accompagnée d’une ultime vérification fiscale pour s’assurer qu’aucune dette n’a été omise et qu’aucune obligation n’a été oubliée.
7- Radiation de la société au registre du commerce et des sociétés
La toute dernière étape consiste à radier la société du registre du commerce et des sociétés.
C’est le greffe du tribunal de commerce qui procède à cette radiation, après réception du dossier complet :
- Procès-verbal d’assemblée approuvant les comptes,
- Comptes définitifs de liquidation,
- Et preuve de la publication de l’avis de clôture.
La radiation signifie que la société disparaît juridiquement :
- Elle n’a plus de personnalité morale,
- Ni d’obligation fiscale,
- Ni d’obligation sociale.
L’activité est considérée comme définitivement close.
💡 Bonne pratique 💡
Il est conseillé de vérifier attentivement la confirmation officielle de radiation et de conserver l’ensemble des pièces de la liquidation pendant au moins 10 ans, en cas de contrôle ou de litige ultérieur.
IV – Pièges à éviter et points de vigilance
Société déjà en cessation des paiements
La première erreur fréquente consiste à engager une liquidation amiable alors que la société est déjà en cessation des paiements.
Dans ce cas, le tribunal pourra requalifier la procédure en liquidation judiciaire, avec des conséquences nettement plus lourdes, notamment pour le dirigeant.
Non respect des délais
Autre vigilance : le respect des délais.
Une liquidation trop longue peut générer des difficultés supplémentaires, par exemple le maintien des obligations fiscales et comptables tant que la radiation n’est pas effective.
Il est donc essentiel de conserver un rythme soutenu et de communiquer clairement avec le greffe et l’administration fiscale.
Ne pas anticiper la fiscalité
Il faut également anticiper la fiscalité du boni de liquidation, qui sera traité comme une distribution de dividendes, avec des droits d’enregistrement et éventuellement un prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Mieux vaut informer les associés en amont pour éviter les mauvaises surprises.
Négliger la publicité
Enfin, la publicité légale ne doit pas être négligée : chaque publication (dissolution puis clôture) est indispensable pour sécuriser la procédure et garantir la transparence vis-à-vis des tiers.
V – Conseils de praticien pour une liquidation amiable réussie
Même si la liquidation amiable est la voie la plus souple pour fermer une société, elle n’est pas exempte de pièges.
Il est fortement conseillé de se faire accompagner par :
- Un expert-comptable : pour vérifier la situation financière de la société,
- et par un avocat spécialisé en droit des sociétés : pour sécuriser les formalités et la rédaction des actes.
L’assistance de ces deux experts vous permettra d’éviter les requalifications, les oublis et les sanctions administratives.
VI – Différence entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
Il est important de rappeler, la différence majeure entre liquidation amiable et liquidation judiciaire.
La liquidation amiable, décidée librement par les associés d’une société encore solvable, permet de clore l’activité dans un cadre souple et maîtrisé, en conservant la gestion à l’amiable des opérations.
À l’inverse, la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal lorsque la société est en état de cessation des paiements ; elle impose la nomination d’un liquidateur judiciaire indépendant, une procédure plus longue et plus lourde, et peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants.
Ce comparatif souligne tout l’intérêt d’anticiper et de privilégier la liquidation amiable dès que cela est possible.
Tableau comparatif entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
| Critère | Liquidation Amiable | Liquidation Judiciaire |
|---|---|---|
| Conditions | Solvabilité & décision associée(s) | Cessation des paiements |
| Procédure | Privée (décision interne) | Judiciaire (par décision du Tribunal) |
| Résultat | Radiation simple | Jugement de liquidation |
VII – Conclusion
La liquidation amiable offre une sortie propre et ordonnée aux entreprises qui souhaitent cesser leur activité tout en étant en mesure de solder leurs dettes.
La procédure, bien que simplifiée par rapport à la liquidation judiciaire, exige une rigueur absolue dans l’enchaînement des formalités et le respect des délais.
Grâce à une préparation sérieuse, une bonne anticipation des aspects fiscaux et un accompagnement adapté, il est possible de clore la vie d’une société dans les meilleures conditions.
En 2025, la réglementation reste stable, mais les obligations de publicité et de transparence demeurent primordiales.
Pour un dirigeant, comprendre chaque étape, s’entourer des bons conseils et suivre un calendrier précis sont les clés d’une liquidation amiable réussie, sans contentieux ni surprises.
VIII – FAQ sur la liquidation amiable
La liquidation amiable est-elle obligatoire si je veux fermer ma société ?
Non, la liquidation amiable n’est pas obligatoire : c’est une faculté offerte aux associés s’ils souhaitent cesser l’activité de la société de manière anticipée et organisée, tout en étant en mesure de payer leurs dettes.
Si la société est en état de cessation des paiements, il faudra obligatoirement passer par une liquidation judiciaire.
Les autres alternatives sont la cession de l’entreprise ou la mise en sommeil (cessation temporaire d’activité).
Qu’advient-il des salariés en liquidation amiable ?
Si la société emploie des salariés, le liquidateur doit procéder au licenciement pour motif économique de l’ensemble du personnel, après la décision de dissolution.
Cela suppose de respecter la procédure classique de licenciement : entretien préalable, notification écrite, délai de préavis, versement d’indemnités légales et de documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi).
Il convient aussi de vérifier qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est exigé selon l’effectif.
La liquidation amiable n’exonère pas de ces formalités ; le liquidateur engage sa responsabilité s’il ne les respecte pas.
Est-ce que je peux faire la liquidation amiable seul, sans expert ?
En théorie, oui.
Les associés peuvent nommer n’importe quelle personne comme liquidateur amiable, même l’un d’eux ou le dirigeant en place.
Cependant, la procédure implique des obligations juridiques, comptables et fiscales assez rigoureuses.
Il est donc vivement recommandé de se faire accompagner d’un expert-comptable ou d’un avocat pour éviter des erreurs ou des oublis qui pourraient entraîner des sanctions ou une requalification en liquidation judiciaire.
Combien de temps dure une liquidation amiable ?
Il n’existe pas de délai légal strict, mais en pratique la procédure dure généralement entre 3 et 12 mois.
Cela dépend surtout de la complexité de la réalisation de l’actif, du règlement des dettes et de la rapidité des formalités de publication et de dépôt au greffe.
Plus l’actif est important ou complexe à vendre, plus la liquidation sera longue.
Qui choisit le liquidateur amiable ?
C’est l’assemblée générale extraordinaire des associés qui nomme le liquidateur amiable, au moment de la décision de dissolution.
Ce choix est inscrit dans le procès-verbal de l’assemblée.
Le liquidateur peut être le dirigeant, un associé ou un tiers extérieur à la société.
Que se passe-t-il si l’on découvre de nouvelles dettes pendant la liquidation amiable ?
Si la société n’est plus capable de régler ses dettes au cours de la liquidation amiable, le liquidateur doit le déclarer au tribunal de commerce.
Dans ce cas, la procédure sera transformée en liquidation judiciaire.
C’est une obligation légale, afin de protéger les créanciers et d’éviter une poursuite irrégulière d’activité sans moyens financiers suffisants.
Faut-il informer les clients et fournisseurs ?
Oui, la loi impose de publier un avis de dissolution, puis un avis de clôture de liquidation, dans un journal d’annonces légales.
Ces publications informent l’ensemble des tiers de la situation de la société.
De plus, il est vivement recommandé d’adresser directement une information aux partenaires importants (banque, principaux clients, fournisseurs) pour anticiper toute difficulté de communication.
Quels sont les impacts sur la TVA ?
Le liquidateur doit régulariser la situation de la société au regard de la TVA avant la clôture.
Cela implique de déposer une dernière déclaration de TVA, de payer le solde éventuel, et de clôturer le compte fiscal.
L’administration fiscale pourra demander un contrôle de cohérence entre le chiffre d’affaires déclaré et la réalisation de l’actif.
Il est indispensable de solder la TVA collectée, et de récupérer la TVA sur les biens invendus ou détruits selon les règles en vigueur.
Qu’est-ce que le boni de liquidation ?
Le boni de liquidation correspond au solde positif restant une fois toutes les dettes réglées et l’actif liquidé.
Il est réparti entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Ce boni est assimilé à une distribution de dividendes et est soumis à l’impôt, notamment au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou, sur option, à l’imposition au barème progressif après abattement.
Comment sont imposés les associés sur le boni de liquidation ?
Le boni de liquidation est considéré fiscalement comme un revenu distribué.
Cela signifie qu’il est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux), sauf option pour le barème progressif après abattement de 40 % sur la part correspondant aux dividendes.
Concrètement, chaque associé est taxé sur sa quote-part de boni au moment où celui-ci lui est attribué.
En pratique, le liquidateur transmet les informations à l’administration fiscale, et les associés déclarent la somme dans leur propre déclaration de revenus.
Et s’il n’y a pas assez d’argent pour rembourser tout le monde ?
Dans ce cas, la société n’est pas en situation de liquidation amiable, mais en état de cessation des paiements.
Le liquidateur est tenu de demander au tribunal de commerce l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Il est interdit de continuer la liquidation amiable si la société n’a pas les moyens de désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Que doit-on déposer au greffe pour une liquidation amiable ?
Au début de la liquidation, il faut déposer :
- Le procès-verbal de dissolution,
- Et la désignation du liquidateur.
À la fin, le liquidateur doit déposer au greffe :
- Le procès-verbal d’approbation des comptes définitifs de liquidation,
- Les comptes de liquidation eux-mêmes,
- Ainsi que la preuve de l’avis de clôture publié dans un journal d’annonces légales.
Ce dépôt permet au greffe de radier définitivement la société.
Y a-t-il un contrôle fiscal à la fin d’une liquidation amiable ?
Il n’existe pas de contrôle automatique, mais l’administration fiscale peut exercer un droit de vérification, notamment si des mouvements de trésorerie ou des cessions d’actifs paraissent anormaux.
Il est donc crucial de présenter des comptes de liquidation parfaitement transparents et de justifier toutes les opérations (ventes d’actifs, remboursement des dettes, versement du boni).
Souvent, le greffe exigera l’attestation de régularité fiscale avant d’enregistrer la radiation.
Puis-je réutiliser le nom de la société plus tard après une liquidation amiable ?
En principe, oui.
Une fois la société radiée, la dénomination redevient disponible au bout d’un certain temps.
Il est toutefois préférable de vérifier auprès de l’INPI ou du greffe si un tiers ne l’a pas réservée entre-temps, surtout si la marque a une valeur commerciale ou est connue sur le marché.
Vous souhaitez réaliser une liquidation amiable de votre société ?
Maître FACCHINI, avocate en droit des affaires, vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux droit des sociétés :
- Création de sociétés : SAS, SARL, SCI, SASU, EURL, SA…
- Rédaction de pacte d’associés
- Contentieux des affaires
- Liquidation amiable
- Cessation d’activité
- Cession de parts
- Suivi juridique
- Etc
👉 Contactez-nous dès maintenant pour un accompagnement sur mesure partout en France.
Contacter Maître FACCHINI Avocat expert en droit des sociétés
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ?
N’hésitez pas à contacter Maître FACCHINI directement sur son téléphone portable, par email ou via le formulaire ci-dessous, un retour vous sera apporté dans l’heure !